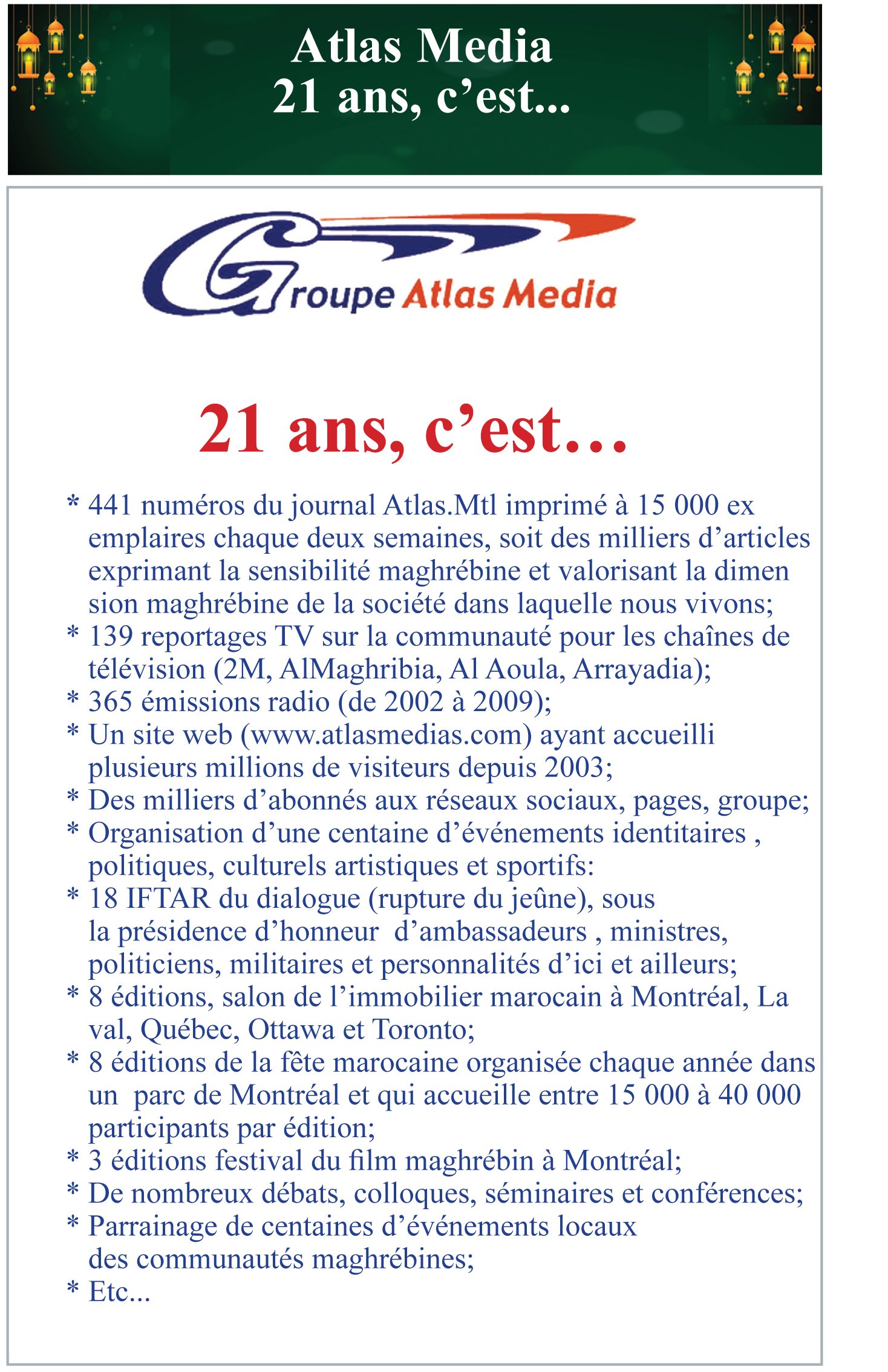Noureddine Razik
Vendredi le 26 Décembre 2014, 19 h 00; Devant un grand public au centre culturel Badr, Arrondissement de St Léonard à Montréal, a lieu une conférence sur Les jeunes et familles musulmanes face à la Loi de la Protection de la Jeunesse.
Sujet d’actualité
Le conférencier M. Noureddine Razik a commencé par expliquer l’historique de la Loi de la Protection de la Jeunesse, sa lettre et son esprit qui s’harmonisent avec les valeurs arabo-musulmane, en précisant que les difficultés qui existent entre le département de la Protection de la Jeunesse et les familles musulmanes, réside dans les procédures d’application de cette loi.
Les interventions de la DPJ dans certaines familles musulmanes, ont été marquées par la tension, et une crise de confiance mutuelle.
Agissant à titre de conseiller interculturel, M. Razik donne depuis plusieurs années, des conférences sur la vulgarisation de la Loi sur la Protection de la Jeunesse auprès des communautés ethniques, notamment la communauté arabo- musulmane, il est également en charge de la formation interculturelle des intervenants. Cette expérience, explique-t- il , lui permet de constater les effets pervers de l’incompréhension entre parents et intervenants, selon M. Razik les enfants se retrouvent au beau milieu d’une guerre froide, parfois ouverte ou la méconnaissance de la culture de l’autre fait des ravages.
Préconisant l’approche préventive, et une relation d’aide respectueuse de la culture de la famille, le conférencier a brossé un tableau peu reluisant de certaines interventions complexes dont les enfants paient les frais , selon ce professionnel de carrière : « parmi les intervenants de la Direction de la Protection de la Jeunesse, il y a des professionnels (lles) compétents, intègres, ouvert d’esprit , mais il y a malheureusement , d’autres qui font preuve de limites en compétence interculturelle, voire de manque d’ouverture face aux différences culturelles , les leurs et celles des parents .
Pourtant, la LPJ est très claire sur le respect de la culture du milieu naturel de l’enfant, ses croyances et ses traditions. Ces balises sont d’ailleurs protégées par la constitution canadienne, la charte des droits et libertés, et même la convention internationale sur la protection des enfants.
Des défis récurrents
Il ajoute, que les familles des minorités ethniques ont toujours constitué un défi, pour la Direction de la Protection de la Jeunesse, dans le cas des familles musulmanes, le choc culturel entre des intervenants et des familles, place des enfants au cœur d’un conflit de loyauté.
La méconnaissance de la culture arabe et musulmane, combinée aux préjugés et stéréotypes véhiculés, compliquent les interventions au sein des familles en difficulté. L’incompréhension est parfois mutuelles, certaines familles sont aussi sur la défensive, et se montrent tout aussi intolérantes, ce qui complique la collaboration.
Des parents «disqualifiés»
Dans leurs interventions durant la période des questions, des parents disent se sentir disqualifiés, par des approches culpabilisantes, et des intervenants envahissants.
Certains, estiment que leurs enfants ont été retirés du milieu familial de façon précoce, brutale, ce qui a laissé des séquelles sur toute la famille.
Après avoir répondu aux questions de l’audience, le conférencier a lancé un appel, pour la constitution de comités de parents, et de familles d’accueil spécifiques, pour offrir leur collaboration à la Direction de la Protection de la Jeunesse.
Il termine : « La DPJ, les parents, et la communauté, ont tous un objectif commun, celui du bien-être des enfants, aider nos enfants, est le point de convergence, qui doit faire dissiper, la méfiance et les préjugés.»
Encadré
À propos du conférencier
Expert en Criminologie, M. Razik œuvre au sein des services sociaux depuis une trentaine d’années, nommé commissaire aux libérations conditionnelles par le gouvernement du Québec, il offre des services de consultations culturelles auprès des tribunaux, et des familles. Auteur de plusieurs articles, M Razik agit à titre de conseiller social, en collaboration avec des organismes communautaires et consulaires.
Par Noureddine Razik (Atlas.Mtl)